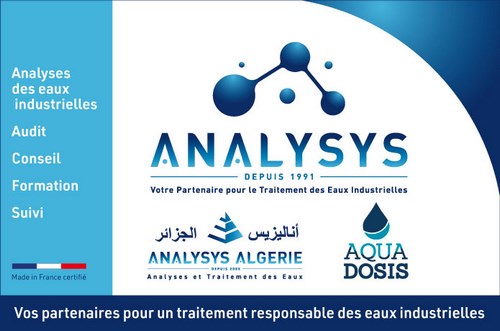Mme. Kahina Mellab Enseignante-chercheure:« Il faut construire notre avantage comparatif agroalimentaire »
- Création : 3 février 2025
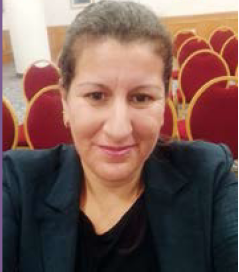
Dans cet entretien, Kahina Mellab, enseignante- chercheure et maître de recherches au CREAD(Centre de Recherche en Économie Appliquée au Développement), estime que l'Algérie dispose indéniablement d'un potentiel agricole considérable. Toutefois, en termes de compétitivité internationale, elle se heurte à plusieurs défis qui entravent son avantage comparatif dans le secteur agroalimentaire.
Agroligne : Dans la structure des exportations hors hydrocarbures, quelle est la place des produits agricoles et agroalimentaires ?
Mme Kahina Mellab : C’est vraiment paradoxal ! L'Algérie, dotée d'un potentiel agricole considérable, se heurte à un paradoxe majeur dans ses aspirations à l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, la stabilité interne des prix (inflation) et la diversification de ses exportations agroalimentaires. Le potentiel est là : capital humain jeune, ressources naturelles, climat varié et situation géographique stratégique.
À mon avis, il faut tout d’abord clarifier ce que l'on vise en priorité : l'autosuffisance alimentaire ou l'exportation des produits agroalimentaires et agricoles. Pour un pays aussi vulnérable structurellement, l’objectif d'exportation nécessite d'intégrer les chaînes de valeur mondiales et régionales, tout en adaptant notre offre agroalimentaire à la demande internationale. La question est complexe et soulève la nécessité de définir précisément quels produits agricoles et agroalimentaires sont essentiels tant pour l’économie que pour la sécurité alimentaire du pays.
L’Algérie importe environ 8 à 10 millions de tonnes de céréales chaque année, principalement du blé tendre (pour la boulangerie) et du blé dur (pour la semoule et les pâtes). Le commerce de ces produits reste menacé par les pratiques protectionnistes de nombreux pays, l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis et les crises internationales (guerre au Proche-Orient, en Europe, et la menace d’une nouvelle guerre en Asie).
De plus en plus, les produits agroalimentaires occupent une place croissante dans la structure des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie, bien qu'ils restent encore marginaux (en phase embryonnaire) par rapport aux exportations des secteurs pétrolier et gazier. Toutefois, avec les réformes économiques et les politiques publiques mises en place ces dernières années pour diversifier l'économie, l’agroalimentaire est devenu l'un des secteurs prioritaires pour l’exportation. Notre économie, qui reste fortement dépendante des exportations d'hydrocarbures (pétrole et gaz naturel), représente environ 95% des recettes d’exportation, rendant ainsi sa structure vulnérable aux chocs externes (prix du pétrole et fluctuations du dollar).
Cependant, les exportations agroalimentaires hors hydrocarbures sont restées faibles, bien qu'elles aient montré une dynamique positive ces dernières années. En 2021 et 2022, le secteur agroalimentaire représentait environ 5 à 6 % du total des exportations hors hydrocarbures. Actuellement, ce secteur ne représente que 1,5 % des exportations totales du pays.
Au début des années 2000, avec la réouverture de l'économie et l'augmentation des prix des hydrocarbures, les investissements dans le secteur agricole ont commencé à croître. Cependant, les chiffres concernant les investissements directs dans ce secteur demeuraient modestes. En 2010, les investissements agricoles ont atteint environ 5 milliards de dollars US, selon certaines estimations liées au Plan National de Développement Rural. En 2014, le gouvernement a annoncé un plan d'investissement de 23 milliards de dollars sur plusieurs années pour le développement rural et agricole, visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire et à intensifier la production. Les investissements agricoles ont continué d'augmenter, atteignant environ 6 milliards de dollars, selon le ministère algérien de l'Agriculture. Bien que la pandémie de COVID-19 ait provoqué des fluctuations dans les investissements, le gouvernement a maintenu ses objectifs d'injection de fonds pour soutenir le secteur agricole, notamment par des subventions aux agriculteurs.
D’une part, malgré des investissements de près de 2,5 milliards USD dans le secteur agricole en 2022, le pays reste fortement dépendant des importations pour de nombreux produits de base, avec environ 70 % des besoins en céréales et 50 % des besoins en produits laitiers couverts par des importations. En 2021, l’Algérie a importé plus de 8,4 milliards USD en produits alimentaires, ce qui souligne l’écart entre les objectifs d’autosuffisance et la réalité du marché. Cette situation est causée par plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques, la gestion des ressources en eau (où seulement 20 % des terres agricoles sont irriguées) et les obstacles liés aux infrastructures.
Comment a évolué la part des exportations agroalimentaires par rapport au potentiel existant ?
Certaines catégories d'exportations agroalimentaires ont montré une dynamique d'exportation plus favorable que d'autres, notamment les agrumes, les légumes (tomates, pommes de terre, oignons), et les fruits (raisins, pommes, dattes). Les produits transformés, tels que le couscous, les conserves de légumes, les jus de fruits, et les huiles alimentaires, notamment l'huile d'olive, ont également connu une meilleure performance. On peut également citer le poisson frais ou congelé, les crustacés et autres produits marins.
En 2022, la part des produits agroalimentaires dans les exportations hors hydrocarbures était d’environ 5,5 %. En 2021, cette part était de 5 %, et en 2020, elle avait légèrement diminué en raison de la pandémie de COVID-19 et de la réduction des exportations, atteignant environ 4,5 %.
En 2023, selon les données du Centre National de l'Informatique et des Statistiques (CNIS) et des Douanes algériennes, les hydrocarbures représentaient 91,5 % des exportations totales, tandis que les produits agroalimentaires représentaient 6 % des exportations hors hydrocarbures (soit environ 2,3 milliards USD). Les produits agricoles bruts (céréales, fruits, légumes) représentaient 1,2 milliard USD, tandis que les produits agroalimentaires transformés (conserves, pâtes, huile d'olive, produits laitiers, etc.) étaient évalués à 1,1 milliard USD.
L'Algérie dispose indéniablement d'un potentiel agricole considérable, mais en matière de compétitivité internationale, elle fait face à plusieurs défis qui freinent son avantage comparatif dans le secteur agroalimentaire. Notre pays possède plusieurs atouts dans ce domaine, mais ils restent sous-exploités en raison de contraintes structurelles, économiques et logistiques. Il est donc essentiel de construire notre avantage comparatif agroalimentaire pour que nos entreprises puissent s'impliquer pleinement sur la scène internationale.
Quelle place pour les produits de terroir ?
Parmi les produits de terroir les plus exportés, on trouve les dattes (l'Algérie étant le premier producteur mondial de dattes Deglet Nour, avec 500 millions USD en 2023), les miels biologiques et médicinaux, ainsi que l'huile d'olive (environ 120 millions USD en 2023), principalement vers l'Europe et le Moyen-Orient. Bien que leur part dans les exportations totales reste encore marginale (environ 0,6 à 1 % des exportations totales de l'Algérie en 2023), elle est en croissance. Ce secteur présente un potentiel de développement considérable, avec des projections de doublement des exportations de ces produits dans les années à venir. Pour y parvenir, il est impératif de :
- Normaliser nos produits agricoles destinés à l’exportation
- Améliorer la qualité et la certification des produits
- Promouvoir les produits sur les marchés internationaux
- Développer la transformation et l'innovation des produits
- Renforcer les capacités logistiques et de distribution à l'international.
Quels résultats des mesures adoptées pour promouvoir les exportations dans les filières agroalimentaires ?
Les mesures adoptées par l'Algérie pour promouvoir ses exportations agroalimentaires ont produit des résultats significatifs, bien que ceux-ci restent en deçà de son potentiel pour atteindre les objectifs de transformation de son modèle économique et de compétitivité sur les marchés mondiaux. Les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d’inciter à la production et à l’exportation des produits agricoles et agroalimentaires, mettant en place plusieurs mécanismes pour soutenir ce secteur. Parmi ces mesures, on peut citer : les prêts à taux préférentiel et les subventions à l’exportation, ainsi que des dispositifs financiers visant à faciliter l'accès au financement pour les PME agricoles et agroalimentaires.
L’Algérie a également mis en place des programmes pour aider les producteurs à obtenir des certifications internationales (par exemple : GlobalGAP, ISO 22000, Bio), garantissant ainsi la qualité des produits destinés à l’exportation. Ces initiatives ont inclus des formations et un accompagnement pour sensibiliser les producteurs aux normes internationales en matière de sécurité alimentaire et de qualité.
De plus, des investissements ont été réalisés dans les infrastructures portuaires, et des efforts ont été faits pour améliorer les réseaux de transport et de stockage, facilitant ainsi l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires. Les autorités publiques ont également créé un fonds de soutien à l’exportation agricole, soutenant notamment la participation à des salons internationaux et mettant en place des bureaux commerciaux à l'étranger pour favoriser l'accès aux marchés internationaux.
En 2023, les exportations agroalimentaires ont atteint environ 2,3 milliards USD, contre 1,8 milliard USD en 2022, soit une augmentation de 28 %. Cette croissance témoigne des résultats positifs de ces politiques, notamment en ce qui concerne le développement de certains produits comme l’huile d'olive bio et les dattes bio. L'Algérie se positionne ainsi comme un producteur clé de ces produits, avec environ 10 000 à 15 000 tonnes d'huile d'olive exportées chaque année, générant entre 30 et 40 millions USD.
Malgré ces progrès, des défis subsistent. Le coût de production élevé demeure un problème majeur pour les producteurs algériens, en raison de l'absence de mécanismes de financement à bas coût, des faiblesses logistiques et du manque d'innovation dans le secteur. Pour surmonter ces obstacles, des réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer l'accès au financement, renforcer les infrastructures logistiques et encourager l'innovation dans les secteurs-clés. Ces efforts permettraient non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi d’améliorer la compétitivité des entreprises algériennes tant sur le marché intérieur qu'international.
Comment s'annoncent à votre avis les perspectives dans ce cadre ?
Les perspectives à long terme pour le secteur agricole et agroalimentaire en Algérie sont globalement optimistes, mais elles nécessitent des efforts conséquents en matière d’investissements, de réformes institutionnelles et de diversification de l'offre.
Si le pays parvient à améliorer ses infrastructures et ses capacités logistiques, à poursuivre les réformes économiques et à faciliter l’accès au financement (notamment par la révision et la modernisation du système bancaire, ainsi que la promotion de la finance islamique pour faciliter l’accès au crédit), ces mesures pourraient conduire à une réduction substantielle du coût de production et à un renforcement de la compétitivité, tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi et de croissance. Il est également essentiel de développer la formation dans ce secteur, avec la création d’écoles et de centres de formation spécialisés, afin de développer le capital humain nécessaire. Par ailleurs, il serait pertinent de renforcer le transport aérien, particulièrement adapté à l'exportation de produits agroalimentaires périssables.
Cependant, plusieurs obstacles structurels demeurent, notamment dans l'exécution des réformes, la gestion des ressources et la mobilisation des acteurs privés et publics. La clé réside dans une approche pragmatique et bien coordonnée des politiques économiques à mettre en place. Cela nécessite une concertation entre toutes les parties prenantes de la société. Heureusement, le débat est déjà ouvert sur la question, et il est encourageant de voir des efforts pour améliorer davantage la productivité du secteur.
Source: Rédaction Agroligne